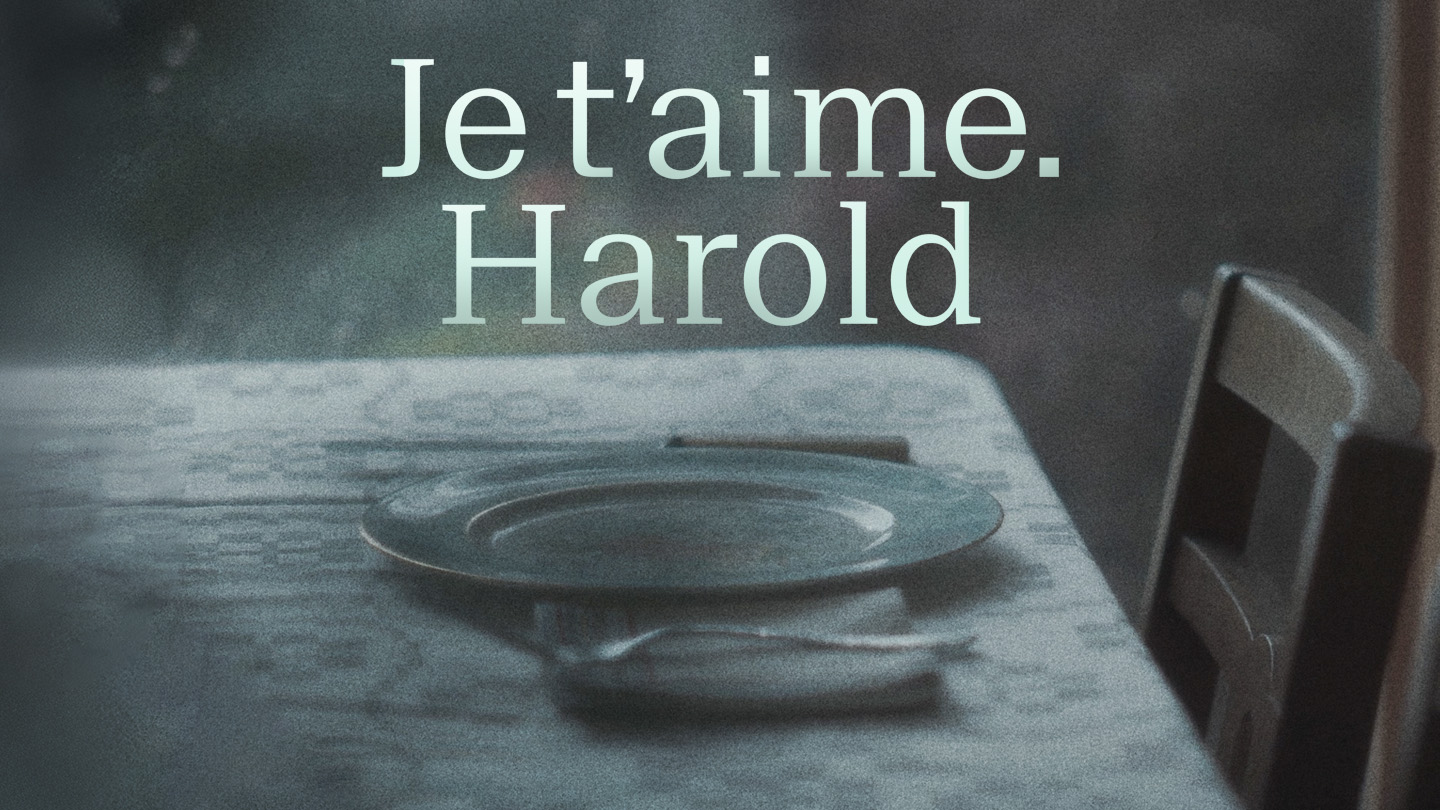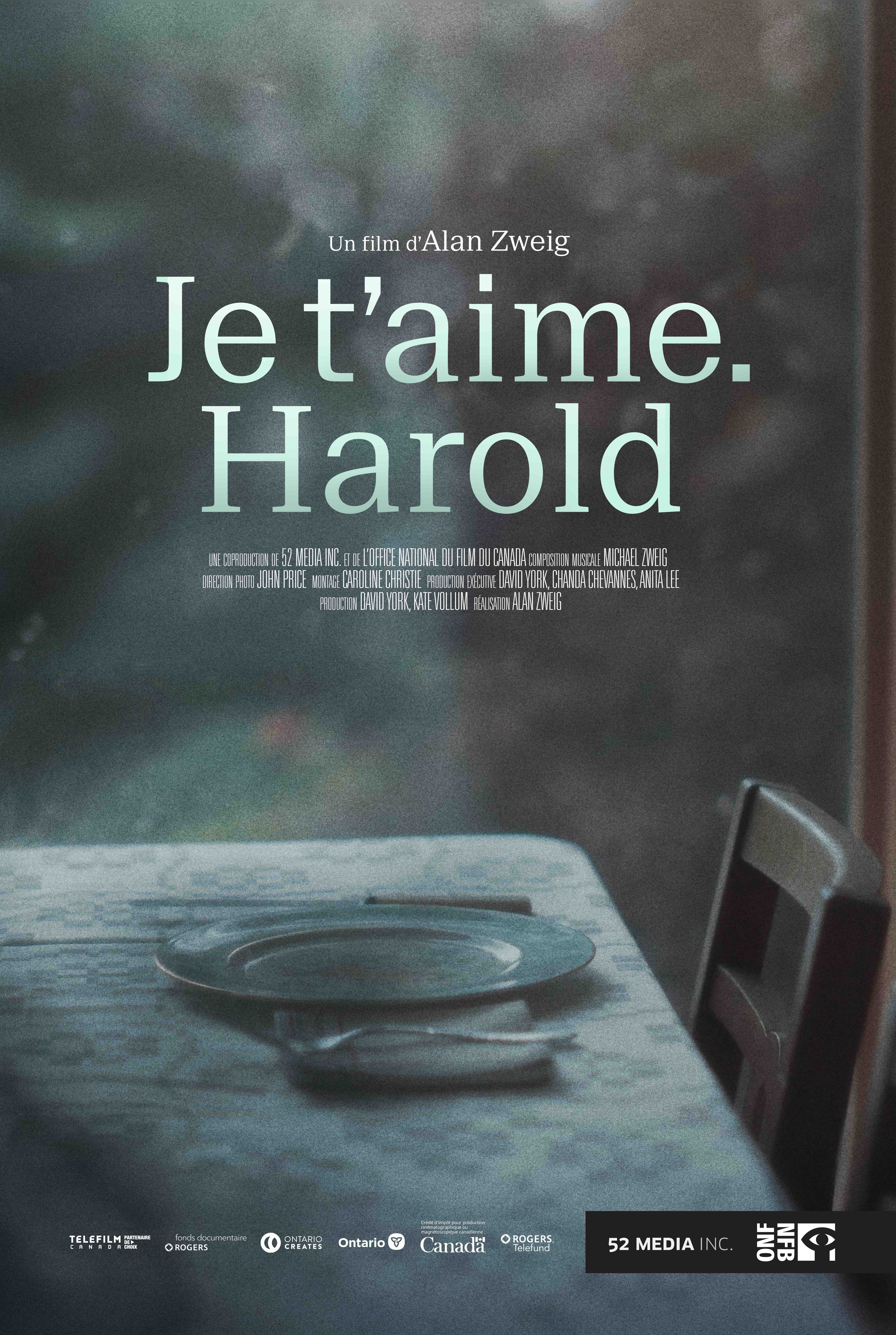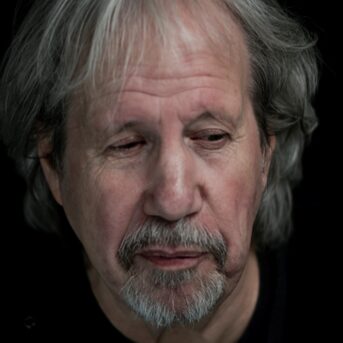Je t'aime. Harold
2025 | 90 min
Documentaire
anglais
Prix et festivals
Sélection officielleFestival international du film de Calgary, Canada (2025)
Sélection officielleFestival international du film de Windsor, Canada (2025)
Une coproduction de 52 Media Inc. et de l’Office national du film du Canada
Ébranlé par le suicide d’un ami, le documentariste émérite Alan Zweig cherche des réponses auprès de plus de 20 individus ayant vécu une perte semblable.
Avertissement: Ce film aborde le thème du suicide et ses effets sur les proches des personnes disparues. Si vous avez besoin de soutien, veuillez communiquer avec votre centre de crise local. Si vous avez besoin d’aide immédiate, veuillez composer le 9-8-8.
Synopsis
En deux lignes
Dans un geste de cinéma plein d’amour et de sincérité, l’un des documentaristes les plus singuliers du Canada explore la douleur et la résilience de personnes ayant vécu le suicide d’un être cher.
Synopsis moyen
Après le suicide d’un vieil ami, le documentariste Alan Zweig part à la rencontre d’autres personnes ayant vécu une perte semblable. Malgré la difficulté à aborder un sujet aussi douloureux, le cinéaste amène plusieurs de ses connaissances à mettre des mots sur leur deuil. Il tisse leurs témoignages en un film choral qui révèle avec une sincérité désarmante le chagrin et la résilience de celles et ceux restés derrière. Je t’aime. Harold est un geste de cinéma plein d’amour et d’empathie de l’un des grands noms du cinéma canadien.
Entretien avec le réalisateur Alan Zweig
Pouvez-vous nous parler de la genèse de Je t’aime. Harold?
Ce ne sont pas tous les événements de la vie qui me donnent envie de faire des films. Je n’aurais jamais abordé ce projet si mon ami Jim ne s’était pas suicidé. Plus tard cet été-là, la sœur d’une amie s’est aussi enlevé la vie. Il y a donc eu plusieurs suicides de suite dans mon entourage. J’ai commencé à réfléchir aux répercussions de cette tragédie sur les gens, à la manière dont on est affecté, même quand la personne qui met fin à ses jours est une célébrité, quelqu’un qu’on ne connaît pas personnellement. Je me souviens, par exemple, avoir été très perturbé par le suicide de Spalding Gray. C’est comme ça que j’ai envisagé de réaliser un documentaire sur ce sujet. J’ai soumis le projet et il s’avère que celui-ci n’a pas été refusé!
Comment avez-vous trouvé vos protagonistes?
J’avais quelques histoires comme point de départ. On a d’abord entamé un processus de recherche conventionnel, mais sans succès. Il y avait bien quelques histoires, mais aucune des personnes concernées ne souhaitait participer. C’est quelque chose qui revenait souvent : soit c’était trop récent pour les proches, soit c’était un secret de famille. J’ai donc commencé à interroger au hasard toutes les personnes que je connaissais. En fin de compte, tous mes sujets sont soit des proches, soit des connaissances, ou encore des tierces personnes que j’ai trouvées par leur intermédiaire. Et comme c’est presque toujours le cas, j’ai interviewé tous les gens qui ont accepté de participer.
J’aime travailler avec une variété de personnes, non seulement d’un point de vue sociodémographique, mais aussi sur des plans plus subtils : par exemple, la façon dont les gens racontent leur histoire, les émotions qu’ils laissent paraître ou gardent en eux. Après une des entrevues, la personne interrogée m’a téléphoné pour s’excuser de sa nervosité. Elle pensait ne pas avoir répondu à mes attentes. J’ai répondu : « Malgré ton agitation, à un moment donné, ton visage a eu une expression incroyable : il est passé de la compréhension à la tristesse, et c’est l’un des plus beaux moments du film. » Mes films sont tous des récits collectifs rassemblant beaucoup de voix différentes, et je recherche donc toujours cette variété.
Comment décririez-vous votre technique d’entrevue?
Je ne fais jamais d’entretiens préalables. Je ne veux pas que mes sujets soient interviewés par quelqu’un d’autre que moi ou avant le jour du tournage. J’aime que les entrevues soient aussi candides et spontanées que possible. Je ne veux pas que les gens s’attendent à des questions particulières ou qu’ils préparent leurs réponses. Il y a un risque de manquer un élément important qui aurait pu ressortir lors de la recherche, mais, selon moi, cela en vaut la peine afin d’aborder l’entrevue avec un regard neuf. C’est essentiel pour moi.
On me dit souvent que je réalise de bonnes entrevues, et on me demande comment j’établis le lien de confiance. Mais la confiance n’est pas un enjeu pour moi. Mes sujets n’ont aucune raison particulière de me faire confiance. Ils me confient ce qu’ils ont envie de me confier. Je sais que j’ai un côté tenace qui me pousse parfois à poser des questions que d’autres ne poseraient pas; c’est une approche que je suis prêt à risquer.
Quelle a été votre implication dans le processus de montage?
C’est le montage qui m’a donné envie de faire des films, et je participe donc toujours au montage de mes films. Bien sûr, c’est un processus collaboratif. Il y a quelques années, j’ai organisé un séminaire pour de jeunes cinéastes à Hot Docs, et je me souviens leur avoir dit : « À moins que vous n’en ayez pas les moyens, ne montez jamais vos propres films ». Je sais donc à quel point il est important d’avoir un autre regard que le sien sur le matériel. J’ai eu la chance de travailler avec Caroline Christie, l’une des meilleures monteuses au Canada.
Il y a des cinéastes qui confient leur matériel à un monteur ou une monteuse et qui reviennent lorsque le travail est terminé, mais ce n’est pas ma façon de travailler. Caroline travaillait seule de temps en temps, mais j’étais généralement avec elle dans la salle de montage. Toutes les décisions clés (structure, rythme, etc.) ont été prises en collaboration.
Les films sont des illusions. On lance des balles en l’air et on essaye de ne pas les laisser retomber. C’est ce qu’on fait quand on monte un film. On collabore avec la personne au montage en utilisant toutes les astuces possibles et imaginables pour garder ces balles en l’air.
Votre réflexion sur le suicide a-t-elle évolué au fur et à mesure de la production?
Je ne suis pas expert en la matière, mais les histoires racontées dans mon film m’amènent à penser que certaines personnes se suicident à cause d’un déséquilibre chimique ou d’une maladie mentale, mais que ce n’est pas le cas de tout le monde. Je ne pense pas que mon ami Jim ait souffert d’une maladie mentale. Il a pris ce qu’il pensait être une décision rationnelle.
Les récits du film suggèrent de toute évidence que certaines personnes préfèrent ne pas parler du suicide de leur proche. Elles pensent que les gens ne veulent pas en entendre parler. J’espère que mon film libérera leur parole. L’écoute de ces histoires, trop souvent gardées secrètes, enrichit notre humanité. Nous nous devons de les écouter. Je n’ai jamais autant ressenti cela qu’avec ce film.
Les gens me demandent s’il a été difficile de réaliser un film sur un sujet aussi douloureux, mais ce projet m’a fait vivre ce que j’appellerais une expérience spirituelle. Ces récits sont précieux, c’est un privilège de les écouter. À un moment donné pendant le tournage, quelqu’un a dit quelque chose de si profondément triste et de si parfait que j’ai eu l’impression que la pièce s’était soudain remplie d’une lumière blanche. Mon équipe et moi-même l’avons ressenti, comme si une vérité profonde venait d’être exprimée. Si j’étais croyant — ce qui n’est pas le cas —, je dirais qu’un ange est descendu du ciel et nous a bénis.
Avez-vous été influencé au cours de votre carrière par des films ou des cinéastes de l’ONF?
Il y a beaucoup de films de l’ONF que j’aime. Je ne sais pas s’ils m’ont influencé, mais ils m’ont certainement inspiré. J’adore les films d’Arthur Lipsett, même si son influence ne se sent pas dans mon travail. Mike Rubbo est quelqu’un dont le travail m’a profondément marqué. J’ai vu Waiting for Fidel alors que j’étudiais encore en cinéma, et j’ai rencontré Mike par la suite. On s’est vus à Montréal et il m’a fait visiter les bureaux de l’ONF. Waiting for Fidel est un film extraordinaire. Tout est fondé sur l’attente : le trio du film ne rencontre jamais Castro, c’est ça qui est génial. Ce documentaire m’a donné la permission de faire le genre de films que je réalise.
Affiche
Bande-annonce
Extraits
Images
Équipe
Générique
Dédié à la mémoire de
Harold Hester
Christopher Glaus
RM Vaughan
Catherine Sing
Peter Slaughter
Robert James Pett
Jordan de Belen
Alan Wright
Ian Worang
Ruby Thomas
Christina Baillie
Katharine Mulherin
Karyn Dwyer
Jeremy Salzman
Aaron Clarke
Garth Wilson
Avec la participation de
Colin Hester
David Hull
Mark Thompson
Lisa Pereira
Deborah McCloskey
Graham Slaughter
Gordon Fick
Patrick de Belen
Lisa Lindstrom
Lynne Parker
Kieran Grant
Koren Hobbs
Martha Baillie
Matt Cruikshank
Casey McGlynn
Tony Nappo
Jin Kim Diep
Judy Pereira
Sharron McLeod
Jared Mitchell
Kirsten Johnson
Jamal Severin Watson
John Lennard
Avec la participation additionnelle de
William Beauvais
Valerie Buhagiar
Carolyn Krug
Albert Kussin
Jesse Locke
Nina Okens
Tanya Read
Jacques Sages
Lorraine Scott
Lorne Slotnick
Neil Thomas
Matt Wilson
Tom Willey
Réalisation
Alan Zweig
Production
David York
Kate Vollum
Production au développement
Justine Pimlott
Production exécutive
David York
Chanda Chevannes
Anita Lee
Montage
Caroline Christie
Direction photo
John Price
Musique originale
Michael Zweig
Recherche
Judy Ruzylo
Prise de son
Ryan Cox
Ian McGettigan
Production, responsable des affaires commerciales
Bryn Hughes
Accompagnement au Cambodge
Ouk Chanbophay
Assistance au montage
Arani Sen
Photographie de plateau
Andrew Waller
Montage sonore
Elma Bello
Postproduction vidéo
Victory Social Club
Montage en ligne
Andres Landau
Colorisation
Zach Cox
Assistance à la postproduction
Michal Heuston
Postproduction audio
Formosa Group
Mixage sonore
Lou Solakofski
Transcription et sous-titres
Power of Babel
Conseil juridique
Danny Webber
Hall Webber LLP
Pour l’ONF
Gestion des opérations du studio
Mark Wilson
Administration du studio
Andrew Martin-Smith
Victoria Angell
Production déléguée
Melissa Paduada
Coordination principale de la production
Vaishnavi Sambhus
April Dunsmore
Conseil principal, mise en marché
Kay Rondonneau
Gestion de projet, mise en marché
Andrea Elalouf
Coordination de la mise en marché
Harmonie Hemming
Relations de presse
Jennifer Mair
Conseil juridique
Peter Kallianiotis
Remerciements
Greg Chown
Rod Cohen
Chris Donaldson
Jon Gardiner
Christy Garland
Kieran Grant
Andy Jones
Grant Lawrence
Andy Meyers
Susheela Meyers
Neil Rough
Banuta Rubess
Produit avec la participation de Téléfilm Canada, Rogers pour le cinéma documentaire et d’Ontario Créatif
Produit avec l’aide du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle du gouvernement de l’Ontario
Produit avec l’aide du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Produit avec l’aide du Téléfonds Rogers
Une coproduction de 52 Media Inc. et de l’Office national du film du Canada
Si vous avez besoin de soutien, veuillez communiquer avec votre centre de crise local.
Si vous avez besoin d’aide immédiate, veuillez composer le 9-8-8.
Relations de presse
-
Sophie St-Pierre
Attachée de presse, ONF
Cell. : 438-336-6449
s.st-pierre@onf.ca -
Jennifer Mair
Attachée de presse – Toronto
C. : 416-436-0105
j.mair@onf.ca | @NFB_Jennifer
-
52 Media Inc.
52 Media Inc. basée à Toronto, est une société de production fondée par le producteur et réalisateur David York. Son travail primé inclut des films, des projets IMAX, des séries télé et plus de 100 heures de télévision documentaire diffusées mondialement. En 2009, Realscreen l’a classée parmi les 100 sociétés de production les plus influentes.
Lancée en 2006, 52 Media a produit des séries comme First Comes Love pour MTV LOGO et Stuck pour W Network. En 2007, la société a réalisé Air India 182, un film diffusé sans publicité sur CBC.
David a réalisé son premier film, Wiebo’s War, en 2011, qui a été présenté dans de nombreux festivals. Entre 2013 et 2020, 52 Media a produit War Story pour History (Canada). La société a également réalisé cinq films pour CBC, dont The Beetles Are Coming et The Way Out.
-
L’ONF en bref
Fondé en 1939 et unique en son genre, l’Office national du film du Canada (ONF) produit, coproduit et distribue des documentaires et des films d’animation engageants, pertinents et innovants. Incubateur de talents, il est un des plus grands laboratoires de création au monde. Depuis plus de huit décennies, l’ONF permet aux Canadiennes et aux Canadiens de se raconter et de se rencontrer. Ses films sont de plus une ressource éducative fiable et accessible. L’ONF possède également une expertise reconnue mondialement en préservation et en conservation, en plus d’une riche collection vivante d’œuvres qui constituent un pilier important du patrimoine culturel du Canada. Jusqu’à maintenant, l’ONF a produit plus de 14 000 œuvres, dont 7000 sont accessibles gratuitement en ligne sur onf.ca. L’ONF ainsi que ses productions et coproductions ont remporté au-delà de 7000 prix, dont 11 Oscars et un Oscar honorifique récompensant l’excellence de l’organisation dans toutes les sphères de la cinématographie.