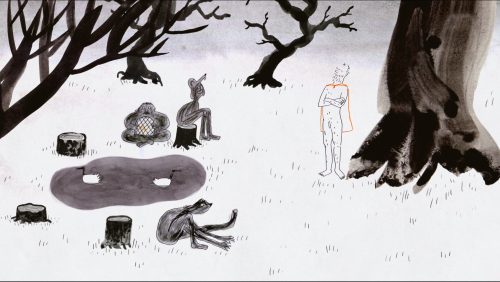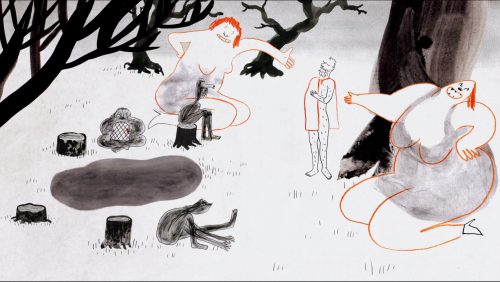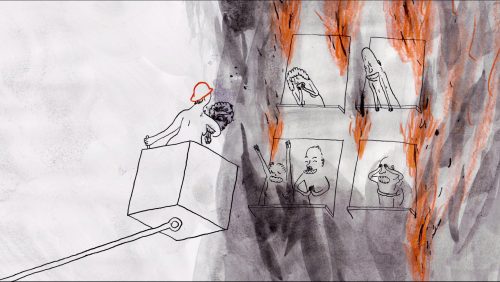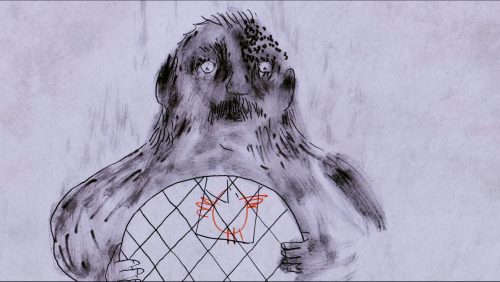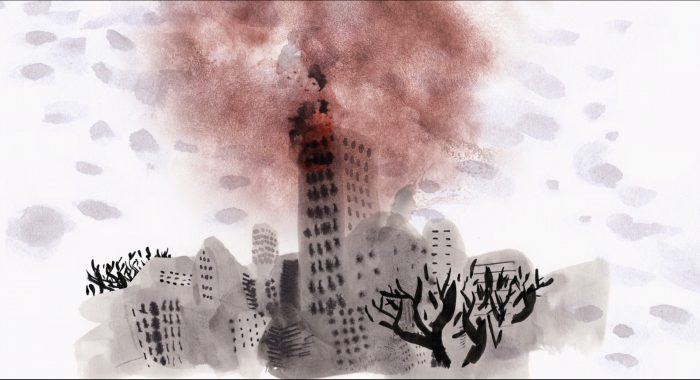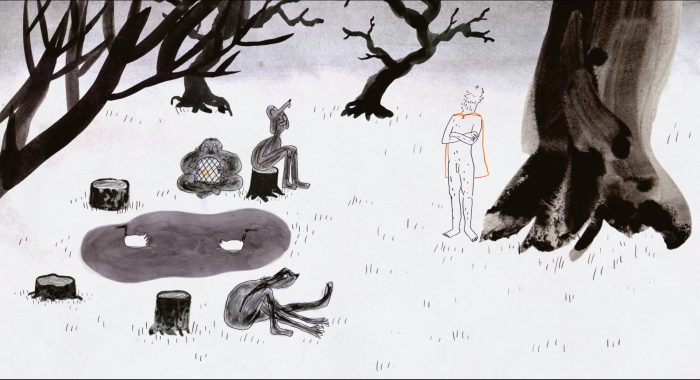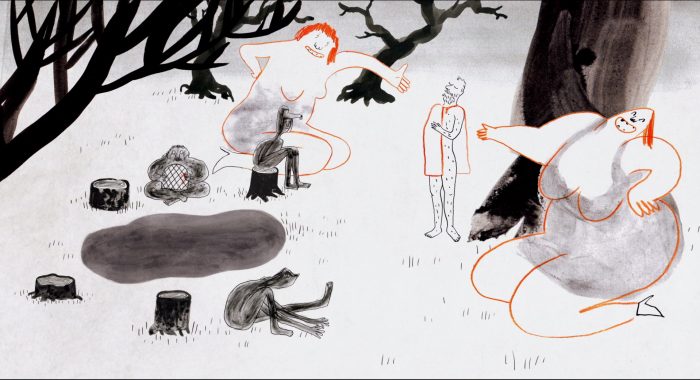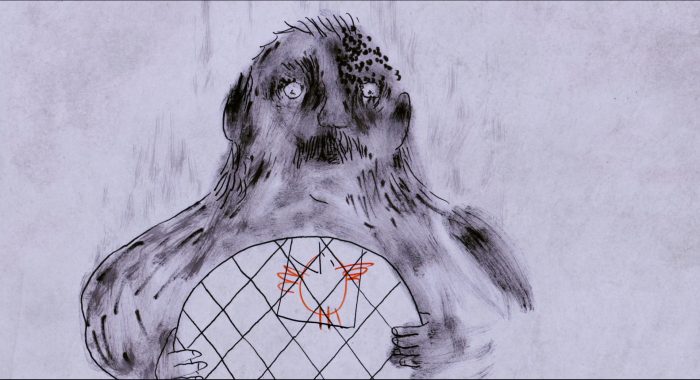Je ne sens plus rien
2016 | 9 min 31 s
Prix et festivals
Film d’ouvertureLes Sommets du cinéma d'animation 2016
Compétition nationale - Courts métrages - Catégorie films professionnelsAnima Brussels 2017
Compétition internationale court documentaire et animationDOK Leipzg 2017
Synopsis
Lui est magicien, elle est pompière. Pour se tenir à l’écart des aléas de la planète agitée, les deux amoureux vaquent à leurs occupations quotidiennes dans une nacelle perchée dans les airs. Leur défi : se maintenir en équilibre tout en haut alors que tout va de travers ailleurs. Mais la vie est ainsi faite que les pompiers doivent éteindre des feux et les magiciens, se donner en spectacle. Comment alors assumer ses devoirs dans ce monde détraqué ?
Auteurs du court métrage d’animation musical Autour du lac, qui avait fait chanter les festivaliers en 2013, les cinéastes belges Noémie Marsily et Carl Roosens signent ici une satire de notre monde en déroute, mettant en cause aussi bien la société du spectacle que la tentation du repli sur soi, faisant surgir l’humour et la tendresse dans le chaos. Soutenu par une ligne agile et souple, le récit de Je ne sens plus rien bascule d’une situation loufoque à l’autre en provoquant chaque fois l’étonnement. Grâce au talent des cinéastes pour la caricature, ce monde improbable ressemble étrangement au nôtre. Le déroulement des péripéties, ponctué d’envolées absurdes, est porté par une riche trame sonore où, en écho au désordre contemporain, s’entremêlent bruits, musique et même la voix de la soprano québécoise Natalie Choquette.
Entretien avec Noémie Marsily et Carl Roosens
Que signifie ce titre énigmatique, Je ne sens plus rien ?
Ce titre est arrivé assez tôt dans le processus. Il renvoie à une forme d’anesthésie, d’engourdissement, qui atteint les personnages du film : la pompière est insensible aux flammes, le magicien disparaît et reste coincé dans cette espèce d’inconsistance, les rescapés de l’incendie sont hébétés et amorphes. Le titre a quelque chose d’un peu indéfini qui nous a accompagnés tout le long de la réalisation.
Votre film dépeint un univers déroutant. Ce que vous montrez est-il une représentation de notre propre monde ? Si oui, qu’avez-vous voulu exprimer et quel est votre constat sur celui-ci ?
Comme nous travaillons de manière intuitive, nous n’avons pas du tout réfléchi à ça au début du projet. Au fur et à mesure que la réalisation avançait, que nous animions ces personnages, cette ville, ces incendies et que tout cela prenait vie, le monde du film s’est concrétisé et on y découvrait de plus en plus de liens avec le nôtre. Donc, oui, cela pourrait être une projection de notre monde, qui contient une sorte de violence constante au milieu de laquelle on essaie de trouver une manière de vivre.
Lorsque nous faisions les premières recherches graphiques, la chanson La ville est triste, du duo français Arlt, nous a beaucoup émus et inspirés : « Le jour est mol, l’amour est fol et la ville est triste… Tout ce vent, tout ce vent, qui a rendu tous ces gens dingues… »
Vous sentez-vous une affinité avec les grands courants belges de l’humour, de l’absurde et du surréalisme ?
Pas particulièrement. Ce sont des choses que nous avons assimilées automatiquement parce que nous baignons dedans depuis longtemps, mais nous n’y faisons pas consciemment référence. Nous habitons en ce moment tout près du musée Magritte à Bruxelles sans y avoir encore mis les pieds… Enfants, nous avons gobé du surréalisme belge à toutes les sauces, mais ce qui nous a marqués, ce sont plutôt les humoristes Les Snuls, le film C’est arrivé près de chez vous, la série de bédé Idées noires de Franquin, les tableaux de James Ensor, le groupe de rock Les tueurs de la lune de miel. Il doit sûrement nous en rester quelque chose…
Dans le domaine de l’animation, quelles sont vos principales sources d’inspiration ?
Ouvre la diversité et la quantité de choses incroyables et inspirantes que nous avons la chance de découvrir ces derniers temps sur Internet et en festivals, voici en vrac les quelques révélations qui ont déclenché chez nous l’envie de faire de l’animation : Patar et Aubier, Priit et Olga Pärn, Phil Mulloy, David Shrigley, Peter Millard… Ce qui nous plaît chez ces artistes, c’est leur grande liberté, leur spontanéité, leur humour aussi, bien sûr…
Carl, vous êtes également musicien et compositeur. Comment cela se répercute-t-il dans votre travail ? Par exemple, accordez-vous une plus grande attention à la dimension sonore et musicale ?
En tant que musicien, j’adore les collaborations, quand un morceau de musique passe entre plusieurs mains. Notre travail avec Pierre-Yves Drapeau, qui a composé la bande sonore de notre film, a été passionnant ! Au fur et à mesure des discussions, des essais, nous sentions Pierre-Yves s’imprégner du film. Il a apporté des choses auxquelles nous n’aurions jamais pensé, comme l’air d’opérette qui revient plusieurs fois. Nous voulions que la musique et les bruitages jouent un rôle narratif important, et ça fonctionne au-delà de nos espérances !
Pour d’autres projets, comme la série hybride Pauvre histoire pauvre, dont j’ai bricolé seul l’image et le son de A à Z, je m’amuse beaucoup. J’ai trouvé ici quelque chose qui rassemble tout ce que j’affectionne.
Comment votre travail en couple se déroule-t-il quand vous faites un film ?
De manière générale, nous échangeons beaucoup, à toutes les étapes. Dès que nous y voyons plus clair, nous allons nous balader pour discuter. Parfois, nous pouvons parler pendant des jours d’un petit détail ; parfois, nous remettons tout en question en cinq minutes. À certains moments, c’est éprouvant, mais quand nous parvenons à faire un bond en avant, c’est grisant.
L’important est d’être sur la même longueur d’onde, de sentir que nous travaillons à la même idée, que nous adhérons tous les deux à ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, nous essayons de fonctionner selon notre envie. Nous nous laissons à chacun une grande liberté, mais nous sommes intransigeants l’un envers l’autre quand nous sentons qu’un truc achoppe. Concrètement, pour ce film, de l’écriture à l’animation, nous avons tout fait ensemble en nous répartissant le travail en fonction de notre intuition.
Je ne sens plus rien constitue votre première collaboration avec l’ONF. Que retenez-vous de cette expérience ?
Ça a été une très riche expérience. Pendant le mois et demi que nous y avons passé, le film n’a cessé d’évoluer, de se bonifier. Lorsqu’on a le nez trop longtemps dans un projet, on ne comprend plus trop ce que l’on est en train de faire, on perd un peu le fil. Les gens que nous avons rencontrés à l’ONF et avec qui nous avons discuté ont véritablement nourri le film et lui ont donné un sacré coup de fouet ! Voir travailler la bruiteuse Lise Wedlock a été incroyable : les images prenaient vie sous nos yeux, on avait enfin un regard nouveau sur le film. La même chose s’est produite à l’étalonnage avec l’excellent travail du directeur technique Pierre Plouffe. Le film a pris chair à l’ONF.
Bande-Annonce
Matériel promotionnel
Images
Équipe
Générique
Scénario, réalisation et animation/ Script, Direction and Animation
Noémie Marsily
Carl Roosens
(Studio cramique)
Cantatrice
Natalie Choquette
Voix
Noémie Marsily
Carl Roosens
Musique originale et conception sonore
Pierre Yves Drapeau
Musiciens
Pierre Yves Drapeau
Denis Chartrand
Bruitage
Lise Wedlock
René Lussier
Enregistrement sonore
Luc Léger
Geoffrey Mitchell
Mixage
Serge Boivin
Remerciements spéciaux à
Isabella Cieli
Bernard Delville
Tomo De Ridder
Annick Faniel
Sacha Goerg
Joanna Lorho
Robin Marsily
William Marsily
Pascal Matthey
Barbara Otto
Charlotte Poels
Nathalie Vanderlinden
Remerciements
Manon Ache
Alexandra Declerc
Martin Delisle
Emmanuelle Duplan
Clara Estable
Guillaume Hittelet
Élisa Labbé
Corinne Le toquin
Léna Martinez
Laureline Massias
Juliette Paquet
Lise Rémon
Pin-Tsen Ye
Merci Sylvia Roosens, Ce film est pour toi
Équipe ONF
Directeur technique
Pierre Plouffe
Coordonnateur technique, animation
Yannick Grandmont
Monteur en ligne
Denis Pilon
Coordonnateur technique
Daniel Lord
Coordonnatrice de production
Michèle Labelle
Administratrice
Diane Régimbald
Équipe administrative
Diane Ayotte
Karine Desmeules
Agente de mise en marché
Geneviève Bérard
Producteurs
Delphine Cousin (Zorobabel)
Delphine Renard (Zorobabel)
William Henne (Zorobabel)
Marc Bertrand (ONF)
Productrice exécutive
Julie Roy (ONF)
Zorobabel
avec la participation du
Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles
En coproduction avec
l’Office national du film du Canada
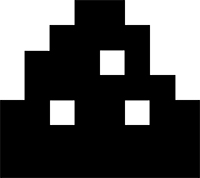

Relations de presse
-
Nadine Viau
Attachée de presse – Montréal
C. : 514-458-9745
n.viau@onf.ca
-
L’ONF en bref
L’Office national du film du Canada (ONF) est un chef de file dans l’exploration de l’animation comme forme d’art, de mise en récit et de contenu innovateur pour les nouvelles plateformes. Il produit des œuvres d’animation audacieuses dans ses studios situés à Montréal, mais aussi partout au pays, et collabore avec les créateurs et créatrices les plus en vue de la planète dans le cadre de coproductions internationales. Les productions de l’ONF ont remporté plus de 7000 récompenses, dont, en animation, 7 Oscars et 7 Grands Prix du Festival d’Annecy. Pour accéder à ces œuvres uniques, visitez ONF.ca.
-
Zorobabel
Depuis 1997, Zorobabel mène une politique de production de films d’auteur. La plupart des réalisateurs avec qui l’atelier travaille en sont à leur premier ou deuxième film. Les courts métrages produits par Zorobabel sont à la croisée de plusieurs pratiques artistiques : théâtre, littérature, danse, musique, arts plastiques, documentaire, etc. Ils sont largement diffusés en festivals et ont remporté de multiples prix (85 à ce jour).